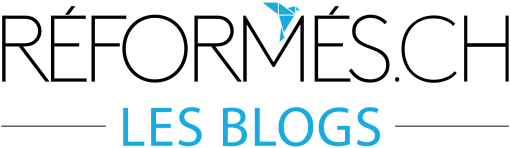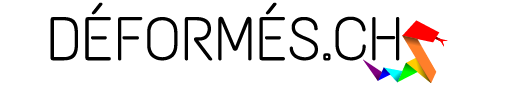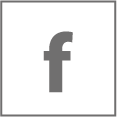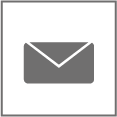Une Eglise peut-elle condamner Israël?
Le 10 avril, l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) publiait une «prise de position» intitulée «Pour la paix, la dignité et la pensée critique». Dans ce texte, l’EERS exprime une nouvelle fois sa profonde tristesse face à la souffrance causée par la guerre persistante au Proche-Orient. Elle dit pleurer «toutes les victimes civiles» et appelle à «la reconnaissance mutuelle, à la justice et au respect des droits humains fondamentaux».
Une déclaration qui contraste avec la position plus directe adoptée au même moment par les Églises protestantes françaises. Le 14 avril, l’Église protestante unie de France (EPUdF) et l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) ont condamné fermement la destruction de l’hôpital Al-Ahli Arab de Gaza par l’armée israélienne, mais également «les attaques incessantes contre la population de Gaza qui bafouent le droit international et des droits humains fondamentaux». Pour autant, face à la guerre en Ukraine, l’EERS a clairement dénoncé l’agression russe à l’occasion des trois ans du conflit, le 24 février. La retenue de la faîtière protestante suisse à propos du conflit israélo-palestinien a donc de quoi interroger: y aurait-il une difficulté particulière à s’exprimer dès lors qu’il est question d’Israël? Interview de Rita Famos, présidente de l’EERS.
L’EERS a clairement identifié la Russie comme agresseur de l’Ukraine. Pourquoi votre dernière «prise de position» sur le conflit au Proche-Orient n’est pas aussi claire concernant les bombardements israéliens à Gaza?
Dans notre prise de position, nous avons exprimé notre deuil face à toutes les victimes civiles, en Israël, à Gaza et dans toute la région. Nos pensées et nos prières accompagnent les familles endeuillées, les blessés, les traumatisées, les personnes enlevées et toutes celles et ceux qui souffrent de la violence, du terrorisme, de la peur et de la destruction. Nous avons délibérément choisi de ne pas formuler une assignation unilatérale des fautes, mais d’exprimer notre compassion face à la complexité de la situation.
Qu’est-ce qui, selon vous, rend la Russie plus clairement «agresseur» qu’Israël?
La Russie a envahi l’Ukraine sans provocation préalable. Elle n’a à aucun moment été menacée militairement par l’Ukraine. Cette attaque constitue une violation manifeste du droit international. Dans le cas d’Israël, nous sommes face à un conflit armé avec le Hamas, dont l’attaque terroriste contre des civils israéliens a déclenché un niveau de violence d’une ampleur inouïe. Dans les deux cas, la souffrance humaine est immense, mais les contextes politiques sont très différents. On ne peut donc pas assimiler Israël à la Russie.
Avez-vous été sollicitée par des partenaires œcuméniques ou des Églises locales (en France, en Palestine ou en Suisse) pour soutenir un appel à la paix ou condamner les attaques israéliennes contre des civils?
Non, nous n’avons jusqu’à présent pas été directement contactés par des Églises ou organisations œcuméniques avec de telles demandes. En revanche, nous recevons régulièrement des lettres de particuliers – avec des attentes très divergentes: certains souhaitent une condamnation explicite d’Israël, d’autres une prise de position claire en sa faveur.
Pourquoi cette nouvelle déclaration, alors? Qu’ajoute-t-elle aux précédentes sur le même sujet?
Il existe un réel danger que nous nous taisions, en tant qu’Eglise, par crainte d'être perçus comme antisémites ou racistes anti-islamiques. Cette déclaration vise donc à rompre le silence. Nous pensons qu’il doit exister un espace pour exprimer l’effroi, la tristesse, l’espérance – même en l’absence de solution immédiate.
Que répondez-vous aux chrétiens qui jugent le silence de leur Eglise comme une forme de complicité?
Une Eglise se construit collectivement. Celles et ceux qui trouvent notre prise de parole insuffisante sont invités à participer, à s’exprimer, à s’engager sur ces questions. L’Eglise, en tant qu’institution, n’a pas pour mission d’agir comme arbitre dans les conflits armés. Notre force réside dans l’accompagnement des personnes, non dans l’attribution des fautes.
Pour leur part, les Églises protestantes françaises ont explicitement condamné les bombardements israéliens sur Gaza. N’est-ce pas le rôle des Eglises face à une guerre aussi controversée?
Il est important de faire preuve de discernement, sans généraliser ni simplifier. L’Eglise n’est pas le lieu où faire de la politique. Elle est cependant un espace où l’on peut pleurer, s’indigner, débattre, espérer et aider concrètement. Nous voulons rendre possibles de tels espaces dans nos lieux de culte et nos différentes présences dans la société. Nous sommes solidaires de celles et ceux qui, sur le terrain, soulagent la souffrance et accompagnent les personnes.
La crainte de heurter certaines sensibilités – notamment juives – joue-t-elle un rôle dans votre stratégie de communication ou est-elle complètement absente?
Nous nous efforçons de communiquer de manière équitable, nuancée et réfléchie à l’égard de toutes les parties. Le respect de nos partenaires juifs, musulmans et aussi des acteurs laïcs, est au cœur de notre engagement. Nous ne disons pas tout ce qui pourrait être dit. Mais nous disons ce qui doit l’être, dans un langage qui respecte la complexité et la souffrance.